
MIEUX CONNAITRE LA MALADIE ET LES TRAITEMENTS
Nos enfants peuvent-ils être atteints ?
La réponse du neuro-oncologue
- La
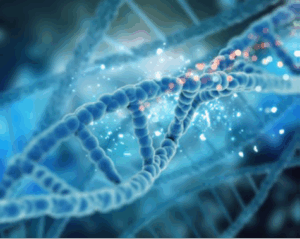 maladie n’est pas contagieuse et les formes héréditaires sont très rares. On retrouve un antécédent dans la famille dans moins de 5 % des cas, sans que l’on puisse écarter l’hypothèse d’une simple coïncidence dans un certain nombre de cas, lorsque par exemple deux membres liés au second degré sont atteints mais qu’aucune altération génétique dont la transmission héréditaire est connue n’a pu être mise en évidence en analysant leur génome constitutionnel
maladie n’est pas contagieuse et les formes héréditaires sont très rares. On retrouve un antécédent dans la famille dans moins de 5 % des cas, sans que l’on puisse écarter l’hypothèse d’une simple coïncidence dans un certain nombre de cas, lorsque par exemple deux membres liés au second degré sont atteints mais qu’aucune altération génétique dont la transmission héréditaire est connue n’a pu être mise en évidence en analysant leur génome constitutionnel
Cependant, certaines maladies héréditaires rares et bien identifiées comme la neurofibromatose ou le syndrome de Li Fraumeni peuvent prédisposer au développement de gliomes malins ainsi qu’à d’autres cancers.
Depuis quand la maladie est-elle présente ? Aurions-nous pu la détecter plus tôt ?
La réponse du neuro-oncologue
- Il est très difficile de dater l’apparition d’un gliome malin. En effet, il peut rester asymptomatique tant qu’il ne se développe pas dans une région “fonctionnelle” du cerveau dont l’atteinte va entraîner un retentissement clinique (comme une gêne dans une fonction, comme la faiblesse d’un membre ou des difficultés de langage) ou que son volume n’est pas suffisamment important pour causer des maux de tête.
- Par ailleurs, si la majorité des gliomes sont d’emblée malins et croissent rapidement pour devenir symptomatiques en quelques semaines, d’autres plus rares résultent de la transformation progressive d’une tumeur au départ non maligne (on parle de gliome de bas grade) vers un gliome malin, processus qui peut prendre parfois plusieurs années.
La date des premiers symptômes imputables à la tumeur permet alors de dire qu’elle était déjà présente à ce moment mais ne permet pas de dater le moment de son apparition. Cette question porte souvent en elle l’idée et parfois la culpabilité de n’avoir pas été suffisamment attentif et de n’avoir pas “consulté plus tôt”.
- Ce sentiment concerne aussi bien le patient, ses proches et le médecin de famille. Pour la grande majorité des gliomes malins représentée par les glioblastomes, la maladie remonte tout au plus aux quelques semaines ou mois précédant les premiers symptômes, compte tenu de la rapidité de prolifération de ces tumeurs.
Quelles en sont les causes ? Avons-nous, dans notre mode de vie, une responsabilité dans le développement de la maladie ?
La réponse du neuro-oncologue
Les causes des gliomes malins sont mal connues. Contrairement à d’autres cancers, il n’existe aujourd’hui aucun facteur de risque reconnu en dehors de l’exposition dans le passé à des radiations ionisantes (ou radiothérapie) remontant habituellement à de nombreuses années. • Le tabac et l’alcool impliqués dans de nombreux cancers ne semblent ici jouer aucun rôle.

- Le stress ou un choc émotionnel ayant précédé la découverte de la tumeur sont souvent invoqués par les proches mais cela n’a jamais été démontré.
- S’il existe des facteurs de risque, ils sont probablement multifactoriels et intriqués, intéressant possiblement une prédisposition individuelle et l’exposition à des facteurs environnementaux non encore identifiés.
- L’implication des champs électromagnétiques (portables) et des pesticides, pour citer quelques exemples qui ont fait l’objet d’études, reste très débattue.
La réponse de la psychologue
Une fois le problème nommé et les solutions explicitées, viennent souvent les questions relatives au patient lui-même.
“Pourquoi moi ?”
“Pourquoi à ce moment-là de ma vie ?”
“D’où ça vient ?”
“Est-ce là depuis longtemps ?”
- Ces questionnements sont quasi systématiques et remplissent une fonction : essayer de rendre compréhensible la survenue de cet événement aussi déstabilisant. Il n’y a pas aujourd’hui d’explication scientifique à la survenue d’un gliome malin chez une personne donnée, et l’hypothèse que cela serait simplement accidentel est difficile à accepter pour le cerveau humain qui pense sa propre histoire. Nous tolérons mal le vide.
Ce besoin de comprendre pourquoi correspond à une recherche de sens de la survenue de cet événement inexplicable. Cette façon de penser les événements comme des conséquences de nos comportements nous sert habituellement à apprendre de notre expérience, à corriger nos comportements ou modes de vie qui ont entraîné un “problème”, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs.
- Après l’annonce diagnostique, il faut un certain temps pour percevoir et comprendre toutes les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne.
- Dès les premiers temps, les patients perçoivent que “rien ne sera plus jamais comme avant”. Ils ont raison, car effectivement, même si beaucoup de patients peuvent avoir un retour à une vie “normale”, telle qu’il la connaissait avant, il restera toujours la mémoire de l’expérience bouleversante qui a été traversée.
- Comme toutes les autres expériences, parfois heureuses, parfois dramatiques, que nous traversons dans la vie, celle-ci nous constitue et fait de nous ce que nous sommes. Ces expériences de vie difficiles peuvent rendre vulnérables, mais elles peuvent aussi apprendre beaucoup et protéger pour le reste de la vie.
Quels sont les symptômes de la maladie auxquels nous pouvons être confrontés e qui doivent nous alerter ? Que signifient-ils ?
La réponse du neuro-oncologue

- La maladie peut se manifester de façon très diverse. Il peut s’agir de maux de tête (“céphalées”) éventuellement accompagnés de nausées ou de vomissements, mais ils peuvent être absents initialement. Ils traduisent une augmentation de la pression intracrânienne liée à la croissance de la tumeur. Le patient peut aussi présenter des crises d’épilepsie qui s’expliquent par une perturbation soudaine et transitoire du fonctionnement électrique du cerveau. Les crises d’épilepsie se présentent de façon très variable : parfois de façon spectaculaire avec une perte de connaissance et des convulsions qui affectent tout le corps (on parle de crise “généralisée”), souvent de façon plus discrète, en pleine conscience par exemple, par de brèves secousses musculaires d’un membre ou de la moitié d’un corps, ou des difficultés à s’exprimer de quelques secondes passant souvent inaperçues de l’entourage (on parle de “crises partielles”).
Ces manifestations sont passagères et ne préjugent pas du stade d’évolution clinique ; certains patients peuvent faire des crises d’épilepsie comme premier symptôme et d’autres une tumeur en rémission depuis plusieurs mois ou années.

- D’autres symptômes doivent alerter quand ils sont nouveaux ou s’aggravent rapidement, comme des troubles intellectuels, des troubles du comportement, des troubles de l’équilibre. Certains signes traduisent le développement de la tumeur dans des zones anatomiques précises du cerveau qui ont un rôle fonctionnel, comme des troubles du langage, un déficit moteur ou sensitif d’un membre ou de la moitié d’un corps, des anomalies dans le champ de la vision. Chacune de ces manifestations peut être isolée ou s’associer à d’autres. Elles peuvent être aussi trompeuses car leur degré de sévérité n’est pas nécessairement corrélé à la taille de la tumeur. Une grosse tumeur peut ainsi rester longtemps discrète sur le plan symptomatique alors qu’une petite tumeur quand elle est mal placée dans le cerveau peut entraîner un gros handicap. C’est pourquoi l’IRM cérébrale est un examen indispensable pour bien interpréter les symptômes, juger objectivement l’évolution de la tumeur et guider le traitement.
La réponse de la psychologue
- Le cerveau commandant toutes nos compétences, les symptômes peuvent être très variables, à la fois dans leur présentation mais aussi dans leur intensité. De la même façon, chacun d’entre nous, en vieillissant et en acquérant des compétences qui nous sont particulières, le sport, la musique par exemple, développons une architecture cérébrale unique. Ces éléments font que deux personnes avec la même maladie auront des symptômes très différents.
- Cette particularité génère une certaine inquiétude chez les patients et leurs proches qui ne reconnaissent pas forcément la même maladie que la leur chez les patients qu’ils côtoient en salle d’attente de la consultation ou de l’hôpital de jour. Ils s’interdisent la plupart du temps le partage d’expérience, jugeant souvent l’expérience de l’autre plus difficile que la leur qu’ils connaissent mieux pour la vivre. Parfois, la confrontation visuelle avec le handicap des autres patients les projette dans un avenir très inquiétant.

- Par ailleurs, selon ses occupations et sa personnalité, on peut être plus ou moins gêné par le même symptôme. Un trouble de la sensibilité des doigts affectera beaucoup la qualité de vie d’un pianiste concertiste qui a un métier passion alors que ce trouble sera jugé peu impactant par quelqu’un d’autre. Certains patients, avec peu ou pas de symptômes, continuent de travailler ou de mener leur vie pendant les traitements. D’autres, pour lesquels les symptômes de la maladie sont trop présents, doivent s’arrêter mais surtout ils ne peuvent plus faire “comme avant”. Il faut à ce moment apprendre à faire différemment, ce qui peut être difficile lorsque la situation est aussi subie.
- Comme il n’est pas possible, à l’échelon individuel d’anticiper l’efficacité des traitements, il faut les essayer dans l’ordre dans lesquels leur efficacité a été scientifiquement validée, puis juger du résultat à l’épreuve de l’IRM et du discours du patient qui peut dire s’il va mieux ou non. Ceux qui voient leurs symptômes diminuer trouvent du sens dans leurs efforts à vivre quelque chose d’aussi pénible. Ceux qui n’expérimentent qu’une stabilité de leurs symptômes sont parfois déçus d’autant d’investissement pour si peu de résultats. Il existe ici une possible incompréhension entre le patient, sa famille et l’équipe soignante. Il faut pouvoir expliquer que la stabilité des symptômes ou de la maladie sur l’IRM est un résultat satisfaisant : cette maladie, connue pour être agressive, n’évolue plus, les traitements la contrôlent.
- Pour le patient et sa famille il faudra du temps, de la pédagogie et du soutien pour les aider à se projeter dans un avenir avec la maladie et parfois des symptômes qui vont persister. Le fait de devoir se satisfaire de rester malade tout en continuant à recevoir des traitements, qui peuvent être lourds et envahissants en termes de temps et de déplacements à l’hôpital peut générer des phases de découragement chez certains ou à certains moments. Heureusement, la plupart du temps les proches et les patients ne se découragent pas toujours au même moment et peuvent se soutenir les uns les autres, guidés par les équipes soignantes qui essaient de répondre aux préoccupations de chacun.
Quels sont les traitements, leurs buts, leurs contraintes, leurs effets secondaires ? Peuvent-ils laisser des séquelles ?
La réponse du neuro-oncologue
- On distingue les traitements symptomatiques (qui visent à soulager les symptômes de la maladie sans agir directement sur la cause) et les traitements antitumoraux.
- Parmi les traitements symptomatiques, nous avons les anticonvulsivants qui préviennent la survenue de nouvelles crises d’épilepsie, et les corticoïdes qui réduisent les symptômes comme les céphalées en diminuant l’œdème cérébral induit par la tumeur. Comme les corticoïdes au long cours exposent à de nombreux effets secondaires parfois invalidants (diabète, tassements vertébraux, ulcère d’estomac, fragilité cutanée, faiblesse musculaire, insomnie, irritabilité…), les doses doivent être régulièrement réajustées par le médecin en fonction de l’évolution de la tumeur. D’un autre côté, les corticoïdes sont aussi des médicaments bien connus pour leurs effets stimulants ; leur sevrage doit donc être progressif quand il est décidé, car il peut s’accompagner d’une forte fatigue, le temps que l’organisme s’adapte à la nouvelle situation.
- La chirurgie vise à retirer la tumeur, du moins le maximum de ce qui est possible, sans exposer le patient à des séquelles fonctionnelles, c’est-à-dire un handicap qui gênerait la vie quotidienne comme une paralysie ou un trouble du langage. Des progrès très importants ont été réalisés dans les techniques opératoires, les séquelles sont devenues beaucoup plus rares ; il est même possible aujourd’hui dans certaines indications d’opérer un patient en condition éveillée afin de minimiser les risques opératoires. À titre d’exemple, la presse a beaucoup parlé du cas de ce musicien qui jouait de son instrument (l’alto) pendant l’opération de sa tumeur cérébrale de manière à permettre au neurochirurgien d’éviter d’altérer certaines zones cérébrales, ce qui aurait pu l’empêcher de continuer son activité professionnelle.

L’ablation de la tumeur permet d’améliorer rapidement les symptômes (disparition des maux de tête, récupération d’un déficit) et de préparer le terrain pour que les traitements complémentaires (la radiothérapie, la chimiothérapie) puissent être administrés dans les meilleures conditions possibles d’efficacité et de tolérance.
- La radiothérapie est le traitement médical de référence contre les gliomes malins. Les rayons sont délivrés après un “centrage” qui vise à délimiter très précisément la zone du cerveau à traiter, en l’occurrence celle où siège la tumeur (ou celle où elle siégeait, si elle a été opérée) en respectant autant que possible le cerveau sain avoisinant. Elle a pour but de détruire les cellules tumorales qui n’auront pas pu être retirées par le neurochirurgien et réduire le risque de rechute. Le caractère infiltrant de la tumeur suggère qu’il existe des cellules tumorales microscopiques autour de la lésion.
- Pendant la radiothérapie et dans ses suites immédiates, les patients peuvent être gênés de façon transitoire par des troubles de l’attention et de la concentration, et des moments de somnolence ; ces troubles régressent progressivement après quelques semaines. La radiothérapie s’accompagne d’une perte des cheveux dans la zone irradiée. Ils commenceront à repousser après deux ou trois mois, souvent incomplètement.
- La radiothérapie expose aussi à des troubles neuropsychologiques plus tardifs et durables, affectant notamment la mémoire. Tous les patients n’ont pas le même risque de développer ces effets secondaires dont le délai d’apparition et la sévérité sont variables. Les patients âgés et ceux ayant une tumeur étendue y sont les plus exposés. Ces effets doivent être relativisés par rapport à la menace représentée par la maladie elle-même.
- En effet, certains proches semblent parfois plus inquiets des effets secondaires possibles de la radiothérapie, que de la tumeur, alors que son traitement doit être la priorité pour la faire régresser et supprimer les symptômes existants. Le traitement des effets secondaires est préventif et l’individualisation des protocoles de radiothérapie vise à minimiser ce risque d’effets. Pour que les rayons soient bien tolérés par le tissu cérébral qu’ils traversent, la dose de rayons et leur durée d’administration (3 à 6 semaines) sont adaptés à l’âge des patients.

- Selon les protocoles, la chimiothérapie peut s’administrer oralement et quotidiennement durant toute la période de la radiothérapie (on parle de radiothérapie et chimiothérapie concomitante) ou bien après la fin de la radiothérapie avec des cures qui se renouvellent toutes les 4 à 6 semaines (on parle de chimiothérapie adjuvante). Elle est généralement bien tolérée, occasionne rarement des nausées avec les médicaments antiémétiques (médicaments qui réduisent le risque de vomissement), et n’entraîne pas de chute de cheveux. En revanche elle nécessite un contrôle régulier du bilan biologique par des prises de sang. Elle complète l’action de la radiothérapie et peut rendre les cellules tumorales plus sensibles aux radiations.
La réponse de la psychologue
La survenue de la maladie bouleverse la vie quotidienne, pourtant même si elle modifie beaucoup de choses, elle ne change pas tout. Le moment de la chirurgie, qui permettra de poser le diagnostic avec certitude, impose une hospitalisation d’une semaine à une dizaine de jours.
- La radiothérapie avec ses allers-retours itératifs, rend exceptionnelle la reprise du travail. La vie familiale change à la faveur de cette nouvelle donnée, “papa ou maman est hospitalisé, ne travaille plus, reste à la maison, n’est plus comme avant”.

Ces changements sont l’occasion d’expliquer aux enfants ce qui arrive. C’est aussi l’occasion de prendre le temps, de saisir ce moment des traitements et la convalescence qu’ils imposent, pour réfléchir aux priorités que l’on souhaite se donner, pour faire des choix de vie en étant accompagné et soutenu.
- La neurochirurgie est un passage obligé dans le traitement des gliomes malins. Même si le geste se limite à une biopsie, cela permettra de caractériser le sous-type de maladie et de proposer un traitement adapté. Les patients, même si le geste est effrayant, en perçoivent le côté salvateur : ôter le problème de l’intérieur du corps. Parfois, si le volume de la tumeur ôté était important, le soulagement, voire la disparition des symptômes, peut être obtenu. De fait, il est parfois difficile pour les patients de comprendre la nécessité de traitements complémentaires à la chirurgie lorsque le neurochirurgien “a tout enlevé ”.
- Lors d’une neurochirurgie éveillée, le patient participe activement : il répond à des questions ou des stimulations et, dès que la réponse est hésitante ou fausse, cela entraîne l’arrêt du geste du chirurgien. La plupart des patients disent, parfois avec surprise, se remettre très vite d’une neurochirurgie. Ceux qui ont une chirurgie éveillée parlent d’une grande fatigue et d’un certain engagement : “un marathon”.
- Après la neurochirurgie il y a un délai de plusieurs semaines pour organiser la radiothérapie. Ce temps d’attente est parfois difficilement vécu, avec une sensation là aussi décrite en terme de perte de temps = perte de chances. En revanche, le début de la radiothérapie, après plusieurs semaines d’inaction, signe l’entrée dans les traitements actifs.
- Le patient, et souvent son accompagnant, se rendent tous les jours de la semaine sauf le week-end à l’hôpital pour une séance de radiothérapie, parfois s’ajoute une chimiothérapie orale à prendre tous les jours aussi. Il y a un véritable intérêt à organiser la radiothérapie près du domicile des patients, car même si la séance en elle-même ne dure que 10 minutes, ces allers-retours, domicile-hôpital tous les jours pendant un peu plus de 6 semaines sont éreintants. Pendant la radiothérapie, l’arrêt de travail est quasiment obligatoire car la fatigue peut être intense.
- La chimiothérapie orale est souvent perçue comme moins efficace que les traitements par perfusion. En revanche, nos patients sont souvent surpris de bien la supporter et apprécient le confort de pouvoir la prendre à la maison. Cela s’accompagne souvent d’une certaine inquiétude des premières cures quant aux effets secondaires, mais l’équipe soignante se rend disponible y compris simplement par téléphone pour rassurer les patients et leur famille.
« On nous propose un essai clinique. Allez-vous faire de nous des cobayes ? »
La réponse du neuro-oncologue

- Dans le cas d’une maladie grave où les résultats des traitements habituels restent incertains, la proposition de participer à un essai expérimental (ou essai clinique) doit être considérée comme une chance supplémentaire de disposer d’un traitement qui pourrait être actif contre la tumeur et provenant des progrès de la recherche. Il peut s’agir d’un nouveau médicament prometteur, mais ce peut-être aussi une stratégie innovante qui repose sur des traitements actifs déjà connus et largement utilisés.
- Ces traitements expérimentaux ont dû passer par de nombreuses étapes toutes très rigoureuses de validation scientifique et d’autorisations règlementaires sollicitées auprès de l’agence du médicament et d’un comité d’éthique pour pouvoir être proposés aux patients.
- Les patients volontaires inclus dans les essais cliniques sont sélectionnés sur des critères cliniques et biologiques très stricts par rapport à leur aptitude à recevoir ces traitements dans les meilleures conditions de sécurité et ils sont extrêmement bien surveillés avec des bilans et visites très réguliers.
- Bien entendu, l’efficacité et la bonne tolérance des traitements expérimentaux ne sont pas assurés, sinon ils ne s’inscriraient pas dans une recherche clinique, mais le patient reste libre de décider à tout moment de ne plus participer et de revenir à un traitement habituel.
